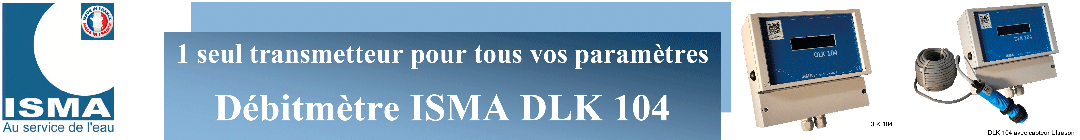La mesure de niveau dans les canaux à ciel ouvert fait partie des paramètres que les acteurs de l’eau se doivent de toujours mieux surveiller dans le cadre d’une meilleure gestion des ressources et de la protection vis-à-vis des risques naturels. Pour cela, ils disposent de plusieurs technologies (bulle à bulle, mesure de pression, ultrasons, radar…), chacune avec leurs avantages et leurs limites, en particulier pour la mesure de débit, même si les nouvelles générations de capteurs radar deviennent des solutions incontournables.
Il n’a échappé à personne que davantage de jours de pluie s’étaient enchaînés ces derniers mois comparativement aux années précédentes. Et ce n’est pas qu’un sentiment: dans son dernier «Bilan climatique 2024 en France», publié début 2025, Météo France a enregistré 1075 mm en moyenne de précipitations sur le pays, l’année 2024 étant excédentaire d’environ 15% et se classant parmi les dix années les plus pluvieuses depuis 1959. Les eaux pluviales et les eaux usées sont souvent acheminées via des canaux à ciel ouvert vers une station d’épuration (STEP), tout comme les eaux de rejet en sortie de STEP et l’eau potable depuis la ressource naturelle (mer, lac, rivière, barrage) vers l’usine de traitement. La surveillance de ces flux – par exemple, une autosurveillance imposée par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 sur les déversoirs d’orage équipant les réseaux d’assainissement – est donc indispensable afin d’optimiser les ressources aquatiques naturelles.

Il s’agit également d’améliorer la protection des riverains vis-à-vis de ce type de catastrophes naturelles. «En raison des contraintes météorologiques, des inondations, etc., il est en effet désormais vital d’informer, le plus rapidement et le plus précisément, les autorités des possibilités d’inondations ou de gestion des canaux d’eau», constate Max Fossey, responsable produit et marché au sein du service marketing de Krohne France. Pour toutes ces raisons, les acteurs du secteur de l’eau contrôlent un large éventail de paramètres, en particulier la mesure de niveau sur canal ouvert. Les capteurs de niveau servent, comme leur nom l’indique, à faire des mesures de hauteur.
Selon les ouvrages sur lesquels ils sont installés, des formules spécifiques sont mise en œuvre afin de transformer les hauteurs en débits sur la base de formules de calcul «hauteur/débit». «Grâce à un capteur radar de niveau, par exemple, et à une relation hauteur/débit via une courbe de tarage, il est possible de calculer le débit. Le principal étant de gérer la formule Q = k x Hn, où Q représente le débit, k et n sont des constantes dépendant de la géométrie du canal», précise Max Fossey (Krohne France).
UN POINT DE MESURE IMPORTANT À PLUSIEURS TITRES

«Le principe de mesure en canal ouvert est utilisé en particulier dans le domaine des eaux usées et des eaux chargées en matières. Il s’agit d’un écoulement libre, ce qui évite les colmatages et permet de faire des mesures visuelles comparatives (à la différence des débitmètres sur conduites)», poursuit Christophe Lichtle, gérant d’Isma. Ce que confirme Emmanuel Kubler, chef de marché Environnement & Énergie chez Endress+Hauser France: «Les capteurs de niveau en canal ouvert sont déployés principalement pour mesurer le débit des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de surface. Ces mesures sont essentielles pour la gestion des ressources en eau, la conformité réglementaire et l’optimisation des procédés de traitement des eaux.»
Les principaux utilisateurs de ces capteurs incluent les exploitants de stations de traitement des eaux, les industriels qui doivent surveiller leurs rejets d’eau, et les collectivités locales responsables de la gestion des infrastructures hydrauliques. Ces mesures de débit en canal ouvert sont la plupart du temps des points de mesure réglementaires qui font l’objet de contrôles réguliers par les agences de l’eau et qui peuvent aboutir à des pénalités financières si les mesures ne sont pas conformes. «De plus, ces mesures sont très souvent associées à des préleveurs automatiques d’échantillons, dont la fréquence de prélèvement doit être réglementairement asservie au débit. C’est donc un point de mesure particulièrement important», insiste Emmanuel Kubler.

Pour la mesure de niveau en canal à ciel ouvert, on trouve quatre technologies différentes proposées par les fabricants de capteurs, à savoir la technique bulle à bulle, la mesure de pression, la mesure à ultrasons et la technologie radar, chacune avec leurs avantages et leurs limitations. «De par sa grande précision et une maintenance limitée, la technologie de bullage est spécialement adaptée à la mesure de niveau en canal Venturi ou pour le diagnostic des réseaux d’assainissement», met en avant Korentin Jolivet, responsable marketing & équipe commerciale sédentaire chez Hydreka (groupe Claire).
Un système bulle à bulle utilise, en fait, un tube immergé dans l’eau et mesure la pression nécessaire pour faire sortir des bulles d’air, cette pression étant proportionnelle au niveau de l’eau – la mesure de niveau est ensuite convertie en mesure de débit. Ces mesures sont effectuées, la plupart du temps, en amont d’éléments hydrauliques aux caractéristiques normalisées ou connues (canal Venturi, plaque déversante…), qui engendrent une restriction de passage, et donc une variation de niveau. Une alternative intéressante aux capteurs traditionnels est proposée par Xylem avec les débitmètres SonTek IQ et IQ-Pipe, qui utilisent la technologie Doppler pour mesurer simultanément le débit, la vitesse et le niveau de l’eau dans les canaux ouverts et conduites partiellement remplies.
«La technologie Doppler permet une mesure précise sans étalonnage, même en présence de faibles vitesses ou de variations du lit hydraulique», explique un expert de Xylem. Faciles à installer grâce à un câblage unique pour l’alimentation et la transmission des données, ces capteurs sont également compatibles avec une alimentation basse tension, rendant leur déploiement possible sur des sites isolés. Chez Prisma Instruments, une approche similaire repose sur un débitmètre à effet Doppler, qui intègre un transmetteur de pression hydrostatique. Installé au fond du cours d’eau, il permet de mesurer simultanément la vitesse du fluide et la hauteur d’eau, offrant ainsi un calcul précis du débit. Sa conception IP68 lui confère une durabilité en immersion permanente. L’exploitation des données peut se faire via ModBus vers un automate ou un enregistreur autonome, avec une transmission possible en 4G vers une plateforme web, assurant un suivi à distance, notamment pour des applications en sites isolés.
DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES CAPTEURS DE PRESSION
«Le principe de fonctionnement bulle à bulle est basé sur un calcul de différence de pression entre celle de l’eau au fond du canal Venturi et celle de l’air ambiant. Nos capteurs fonctionnent en continu afin d’éviter tout risque de colmatage de la canne de bullage, qui est en contact avec les matières. Et nous proposons également des puits de mesure sur mesure pour l’ensemble de nos canaux Venturi. Même si elle est mature, la technologie bulle à bulle reste donc particulièrement bien adaptée aux effluents pouvant produire des mousses [ou avec des débris, NDR]», affirme Christophe Lichtle (Isma). D’aucuns mentionnent, néanmoins, comme limitations, une installation plus complexe et une maintenance plus fréquente qu’avec d’autres technologies de mesure.
Les capteurs de pression sont une autre solution de mesure de niveau en canal ouvert. « Immergés dans le canal ouvert ou le canal Venturi, ces capteurs mesurent la pression hydrostatique exercée par la colonne d’eau pour déterminer le niveau d’eau. Ils sont indiqués pour les applications où beaucoup de mousse se forme en surface. Les autres avantages sont une bonne précision, leur robustesse, leur compatibilité à des environnements avec des débris. En revanche, les capteurs de pression hydrostatique nécessitent un contact direct avec l’eau et ils peuvent être affectés par les variations de température et de pression», énumère Emmanuel Kubler (Endress+Hauser France).
Christian Haritchabalet (Anhydre) partage cette analyse : «Aucune technologie ne présente un couple avantages/inconvénients parfait, c’est pourquoi Pulsar Measurement propose aussi bien des solutions à ultrasons que radar. » Par exemple, le Reflect, un capteur radar fonctionnant sur deux fils, est conçu pour des applications critiques nécessitant une mesure précise des niveaux et volumes, aussi bien pour les liquides que les solides. « Scellé et sans entretien routinier, il résiste aux environnements agressifs (poussières, températures extrêmes, fortes pressions, composés chimiques) tout en garantissant une stabilité de mesure. » L’angle de faisceau de 6°, optimisé par le logiciel DATEM, améliore la précision en se focalisant sur le niveau réel. «L’interface web et la communication Bluetooth sécurisée permettent un accès simplifié aux paramétrages et à l’analyse des tendances », ajoute-t-il. Enfin, il intègre le système tricolore Namur NE-107, facilitant la surveillance de son fonctionnement et la détection d’anomalies.

Guy Deiber, responsable marketing produits chez Vega Technique, fait toutefois remarquer que « les mesures de débit d’eaux usées dans les canaux Venturi par capteur de pression hydrostatique peuvent être soumises à un certain nombre de contraintes qu’il convient de prendre en compte. Les eaux usées en entrée et sortie de station de traitement peuvent engendrer des dépôts sur la cellule de mesure. Afin de faciliter la maintenance du capteur, il sera préférable d’utiliser d’une version équipée d’une cellule de mesure en céramique offrant une grande résistance mécanique lors des éventuelles opérations de nettoyage ».
Il est aussi conseillé d’utiliser un capteur avec parafoudre incorporé et tresse de masse pour limiter les risques de détérioration liés aux surtensions sur les lignes de mesure. Une approche similaire est proposée par Siemens avec le SITRANS LT500, dont la version à ultrasons offre une chaîne de mesure de débit en canal ouvert avec une précision de 1 mm sur une plage de 3 mètres.
Ce que confirme également Dany Engel chez CVenturi, qui recommande l’utilisation d’un capteur à ultrasons DB3 sur ses fabrications de canaux Venturi et de déversoirs : «Ce capteur, conçu spécifiquement pour ces ouvrages, présente une bande morte réduite à zéro et une précision de +/- 1 mm, optimisant ainsi la mesure des faibles hauteurs couramment observées dans les canaux ouverts. La prise en compte de ces faibles variations est essentielle, car une erreur de l’ordre du millimètre peut entraîner des écarts significatifs dans le calcul des débits et volumes. De plus, l’intégration d’une protection solaire vise à stabiliser la mesure en limitant l’influence des variations thermiques sur le capteur. »

«En cas de présence importante de mousse, un capteur de pression hydrostatique à cellule céramique sèche arasante sera privilégiée, parce que la robustesse de la céramique permet un nettoyage minimisant les risques de détérioration du matériel. Pour assurer une grande stabilité de la mesure dans le temps (une stabilité meilleure que 0,1% par an, en référence aux normes DIN 16086, DINV 19259-1 et IEC 60770-1), on préférera la technologie céramique capacitive compensée en température. Le capteur devra, en outre, intégrer un capillaire de respiration, protégé contre la pénétration d’humidité, pour compenser les variations de pression atmosphérique», explique Guy Deiber.
LES ULTRASONS, UNE TECHNOLOGIE SANS CONTACT
Les technologies sans contact représentent une autre grande catégorie de mesures de niveau en canal ouvert. À commencer par les ultrasons: «Ces capteurs mettent en œuvre la technologie ToF (Time-of-Flight ou temps de parcours) des ondes sonores pour mesurer la distance entre le capteur et la surface de l’eau. Avec cette technologie, les utilisateurs bénéficient de plusieurs avantages tels qu’une mesure sans contact, une installation facile et un coût modéré. Les limitations d’un capteur par ultrasons sont toutefois une sensibilité aux conditions environnementales (température, vent), la perturbation possible par la présence de mousse ou de débris, et la nécessité d’être associé à un transmetteur électronique pour le calcul et l’affichage du débit», indique Emmanuel Kubler (Endress+Hauser France).
L’absence de contact avec les effluents apporte un autre avantage, à savoir une maintenance réduite. Christophe Lichtle (Isma) soulève toutefois deux inconvénients : «Il est souvent fait état d’écart de mesure en fonction de la température avec un capteur par ultrasons. Ce n’est pas le cas avec nos capteurs, parce qu’ils sont conçus spécifiquement et uniquement pour la mesure en canal ouvert (compensation en température, profilés “goutte d’eau” pour éviter la formation de condensation sur la base du capteur…). La précision des capteurs du marché peut également être une limitation, mais alors que nos modèles affichent une meilleure précision (de l’ordre du millimètre) sur des faibles hauteurs de canal, grâce à une réduction spécifique de l’étendue de mesure.»
Enfin, comme le mentionne Korentin Jolivet (Hydreka), «la troisième technologie que nous proposons dans notre catalogue pour les diagnostics temporaires réglementaires et l’instrumentation permanente – les deux autres sont la technologie de bullage et la mesure de pression piézométrique – est la mesure radar, toujours sans contact, avec le capteur HR22. Ce dernier se distingue, notamment par l’absence de zone morte facilitant ainsi grandement l’installation dans les réseaux».
DES CAPTEURS RADAR AUX MULTIPLES ATOUTS
Un capteur radar utilise des ondes électromagnétiques pour mesurer la distance d’une manière similaire aux ultrasons, mais avec une plus grande précision et une sensibilité moindre aux conditions environnementales (donc une meilleure adaptation aux environnements difficiles). Aucune technologie n’étant universelle, les capteurs radar peuvent, eux aussi, avoir quelques limitations. «Par exemple, la mesure peut être perturbée lorsque de la mousse dense est présente», signale Emmanuel Kubler (Endress+Hauser France).

Le fabricant a d’ailleurs lancé récemment, sur le marché, une nouvelle gamme de capteurs radar (Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B et Micropilot FMR30B) dédiés aux applications allant de l’industrie de l’eau aux utilités. «Les canaux Venturi étant exposés à des conditions climatiques et à des qualités d’eaux variables, il conviendra de sélectionner l’instrument de mesure le plus adapté à ces contraintes. Pour s’affranchir des gradients de température entre la position du capteur et le niveau mesuré, il sera préférable d’utiliser une mesure radar travaillant dans la bande de fréquence K, qui est insensible aux variations de température et aux forts vents», préconise Guy Deiber (Vega Technique).Comme les canaux de mesure sont souvent exiguës, les utilisateurs devront accorder une attention particulière à l’angle d’émission total du capteur, angle qui ne devra pas excéder 10° (équivalent 5° demi angle). «Et, les capteurs radar émettant dans le milieu naturel, ceux-ci doivent répondre à la norme LPR (Level Probing Radar) EN302729-1/2 pour une utilisation en extérieur», poursuit Guy Deiber. Pour Max Fossey (Krohne France), «les dernières générations de capteurs radars 80 GHz ont désormais des coûts limités. Tous ces avantages font de ces capteurs la solution désormais privilégiée par le marché pour la mesure de niveau en canal ouvert, même si nous proposons, à ce jour, toutes les solutions (capteurs de pression immergeables, par ultrasons)».
Pour Florence Coquet (IFM) «la technologie radar est une solution adaptée pour mesurer le niveau d’eau et d’eaux usées en extérieur dans des fosses ou des canaux ouverts. Avec sa longue portée, notre capteur R1D est utilisé dans les grands réservoirs d’eau et les fosses. Il n’est pas affecté par les conditions météorologiques et mesure en continu le niveau sous la pluie, la neige, le brouillard, le vent et la poussière sans déclenchements erronés.» Sa large plage de température de fonctionnement (-40…85 ºC) lui confère une robustesse particulière pour les installations extérieures. «La communication IO-Link permet également un transfert des données vers le cloud pour un traitement postérieur», ajoute-telle.
Prisma Instruments propose également un débitmètre radar mesurant simultanément la vitesse et le niveau d’écoulement. Avec une sortie 4-20 mA ou ModBus, il s’intègre aux systèmes de supervision et d’enregistrement autonomes. Un logiciel de correction de profil hydraulique améliore la précision dans les canaux non rectangulaires. Ce dispositif est notamment utilisé par Eaux de Paris pour la surveillance des réseaux hydrauliques. En parallèle de l’évolution des capteurs radar, les fabricants ont porté leurs efforts de R&D sur d’autres aspects des capteurs de niveau en canal ouvert. «Au-delà des améliorations non visibles, nous avons beaucoup travaillé sur la facilité d’utilisation et de mise en œuvre: une interface conviviale via des outils tels que smartphone, tablette, ordinateurs, une base de données de formules embarquée, une solution complète en panneaux solaires pour les sites non équipés d’un réseau électrique», cite Christophe Lichtle (Isma).
VERS DES CAPTEURS TOUJOURS CONNECTÉS ET FACILES À UTILISER
Le marché de la mesure de niveau en canal ouvert évolue vers une plus grande intégration des technologies numériques et des solutions IoT (Internet des objets). Les défis incluent la gestion des données en temps réel, la nécessité de solutions plus robustes face aux conditions environnementales changeantes, et la demande croissante pour des systèmes plus durables et économes en énergie. «Nous répondons à ces défis en développant des capteurs plus “intelligents” et capables de fournir des données précises et fiables. Les protocoles de communication tels que le Bluetooth ou le Wi-Fi local sont aujourd’hui un must. Nos capteurs sont dotés de technologies innovantes qui permettent de réaliser des contrôles de fonctionnement (Heartbeat), les résultats pouvant être téléchargés et archivés. Et notre cloud Netilion permet de connecter les actifs et les documentations associées, et de faire vivre les données de la base d’instruments installés de manière dynamique », promeut Emmanuel Kubler (Endress+Hauser France).
Ce que confirme Christophe Lichtle (Isma): «Il y a de plus en plus de capteurs déployés de manière générale. Les vérifications, les maintenances courantes, la récupération de données devenant très chronophages, nous travaillons à faciliter encore plus l’utilisation des capteurs et à rendre les appareils communicants sans fil pour pouvoir connecter des capteurs sans déployer des centaines de mètres de câbles. Cela prendra la forme de la mise en place de notre solution de récupération de données sous forme de bilans mensuels au format Sandre, du développement en cours d’un capteur par ultrasons qui se “calibre” tout seul par mesure comparative en temps réel – il n’y a plus besoin de caler des points zéro car il n’y a plus de dérives – et de capteurs LoRa dédié, ainsi que de l’intégration de solution LoRa en lieu et place des abonnements SIM.»
Cette tendance s’observe également avec le développement de services intégrés à des plateformes de surveillance en temps réel. Le service vorteX-io, initialement conçu pour le suivi hydrométrique des cours d’eau, s’inscrit dans cette dynamique en intégrant un capteur multiparamétrique capable de mesurer simultanément la hauteur, le débit et la température de l’eau. Son intérêt pour les gestionnaires de réseaux d’assainissement et de stations d’épuration réside dans sa capacité à détecter rapidement des variations anormales de niveau, facilitant ainsi l’anticipation des risques de débordement. La surveillance de la température de l’eau constitue également un indicateur pertinent pour identifier d’éventuelles anomalies thermiques liées aux rejets. Toutes les données collectées sont centralisées sur une plateforme dédiée, offrant une vision en temps réel des flux et permettant l’émission d’alertes en cas de dépassement des seuils critiques.