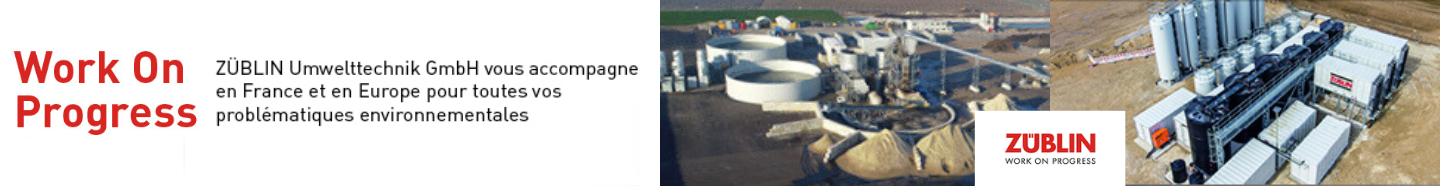En quelques années les PFAS se sont imposés comme une préoccupation environnementale majeure. Cadre réglementaire, solutions techniques et méthodes de mesure se mettent progressivement en place pour dépolluer les masses d’eau et l’environnement et protéger la population. Mais ce sera long et coûteux.
Impossible d’y échapper. Il ne se passe plus un jour sans que tombe une nouvelle liée aux substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS. Les révélations sur ces «polluants éternels » se succèdent: masses d’eau polluées, captages fermés, espèces animales contaminées, etc. Or, les PFAS présentent plusieurs caractéristiques les rendant très difficiles à éliminer. Tout d’abord ils sont omniprésents. Les masses d’eau contaminées ne représentent qu’une facette de la réalité : on en trouve dans les sols, dans l’air, dans les déchets, dans les organismes vivants… «Ramboll prône une approche holistique. On ne peut pas régler le problème de l’eau si l’on n’a pas réglé celui des sols, on ne peut pas régler celui des sols si l’on n’a pas réglé celui de substitutifs aux PFAS dans les procédés de fabrication. On en utilise dans les lentilles de contact, les circuits intégrés, les vêtements imperméables, les mousses anti-incendie, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine, etc. On ne peut pas les interdire partout du jour au lendemain» souligne ainsi Olivier Sibourg, Principal chez Ramboll France, un bureau d’études et d’ingénierie.

«La réglementation européenne sur les polluants organiques persistants (POP) issue de la convention de
Stockholm se met en place progressivement. Elle a interdit le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009, le
PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis
juillet 2020 et le PFHxS (acide perfluorohexanesulfonique) depuis juin 2022
précise », Oliver Chilcott, Responsable
Adjoint Sites et Sols Pollués chez Ginger
BURGEAP, bureau d’études environnement. Par ailleurs, ces molécules sont
caractérisées par des liaisons carbonefluor extrêmement stables, qu’aucun
organisme vivant ne peut dégrader et
rendent certaines molécules susceptibles d'être persistantes dans l’environnement. D’où la difficulté à les détruire
par des procédés physicochimiques.
Enfin, elles sont toxiques à très faible
dose (certain PFAS ont été identifiés
comme potentiellement carcinogènes),
d’où la difficulté à les doser et les retirer
de l’eau, surtout en présence de polluants beaucoup plus abondants.
Face à cela, comment les mesurer ?
Comment protéger ou restaurer les
ressources en eau? Quelles sont les
technologies d’élimination disponibles?
Quel est le cadre réglementaire? Même
si l’on ne part pas tout-à-fait de zéro,
tout cela est actuellement au stade
exploratoire.
UNE RÉGLEMENTATION ENCORE EN GESTATION
L’action publique, tant en termes de réglementation que de plans d’action, se met progressivement en place. Le 5 avril 2024, le gouvernement lançait ainsi un nouveau plan interministériel, remplaçant celui de 2023. Au menu: l’acquisition de connaissances (état des lieux de la pollution, méthodes de mesure, exposition de la population), le renforcement de la surveillance dans tous les milieux, la réduction des risques (restrictions sur la mise sur le marché, production de valeurs toxicologiques de référence, réglementation des rejets, gestion des sites et sols pollués), le soutien à l’innovation dans les domaines du traitement des émissions et la destruction des déchets comme de la substitution, et enfin l’information. Les seules valeurs réglementées à l’heure actuelle concernent les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). La France s’aligne à cet égard sur la directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020. A compter du 12 janvier 2026, l’eau potable distribuée dans les État membres ne devra pas contenir plus de 500 nanogrammes par litre (ng/L) de PFAS totaux, ce que la directive appelle «Total PFAS».

Pour les 20 molécules considérées comme les plus préoccupantes (dont le PFOA et le PFOS), cette somme, alors appelée «Somme PFAS», ne doit pas dépasser 100 ng/L. Selon les termes de la directive, «les États membres pourront alors décider d’utiliser l’un ou l’autre des paramètres «Total PFAS» ou «Somme PFAS», ou les deux paramètres.» La même directive fixe également des seuils sanitaires pour d’autres polluants, comme par exemple le bisphénol A, les chlorates ou les chlorites, qui préoccupent déjà les traiteurs d’eau. En ce qui concerne les PFAS, une évolution rapide de ces valeurs limites est à prévoir car les connaissances s’accumulent. Aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency (EPA) a édicté le 10 avril 2024 des normes fédérales beaucoup plus sévères pour l’eau potable, fixant le seuil à 4 ng/L pour le PFOA et pour le PFOS. Concernant le PFNA, les PFHxS et le HFPO-DA, la limite individuelle est de 10 ng/L. Dans plusieurs pays européens, entre autres le Danemark ou la Belgique, des seuils admissibles beaucoup plus bas que ce que prévoit la directive européenne sont d’ores et déjà institués. «En s’appuyant sur cette directive, récemment, l’ANSES a recensé pour l’eau de boisson une liste des différentes VR (valeurs de référence) existantes au niveau mondial pour chaque substance listée dans cette directive, ou proposé des VR sur la base de VTR (valeurs toxiques de référence). L’ANSES ne donne cependant pas son avis, qui est attendu pour avril 2025. Les normes et références évoluent très rapidement, obligeant les différents acteurs à être proactifs et à anticiper les futurs textes réglementaires à venir», ajoute Oliver Chilcott.
QUE CONTRÔLER ET POURQUOI ?

Les PFAS sont omniprésents mais la mesure de leur niveau répond à différentes préoccupations selon la masse d’eau envisagée. «Ainsi, il est essentiel de comprendre l’origines des pollutions potentielles dans l’environnement, d’identifier le type de PFAS utilisés ou rejetés et de déterminer les ressources à protéger», confirme Oliver Chilcott, membre du groupe de travail PFAS Ginger BURGEAP. En ce qui concerne les rejets industriels, la motivation est claire: il s’agit d’identifier les sources de pollution. Le plan d’action interministériel poursuit à cet égard la lancée de 2023, stipulant que «l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 a imposé la réalisation d’une campagne de mesures des PFAS dans les rejets aqueux de nombreux sites industriels potentiellement les plus concernés par ces substances, notamment les installations de production de produits chimiques, de fabrication de textiles, de stockage et de traitement de déchets et les stations industrielles d’épuration des eaux usées, etc. Ainsi, de septembre 2023 à juin 2024, environ 4000 sites doivent analyser, à trois reprises, leurs rejets aqueux pour évaluer leur concentration en PFAS.» Bertand Latrobe, Principal chez Ramboll, y voit un premier pas. «En France comme en Europe, on est actuellement plus dans une démarche d’analyse et d’identification des sources que de traitement. On y viendra ensuite, inévitablement» estime-t-il.
«Nous en sommes au stade de la récolte des 3. Voir https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/02/23/polluants-eternels-explorez-la-carte-d-europe-de-la-contamination-par-les-pfas_6162942_4355770.html données. Nos clients industriels doivent réaliser des analyses sur leurs rejet mais nous leur conseillons de le faire aussi sur l’eau qui entre dans leur process. C’est en effet la différence entrée-sortie qui établira s’ils sont producteurs nets de PFAS. Il sera alors temps de réfléchir à la remédiation» précise pour sa part Ludovic Lemieux, Responsable technique des produits formulés chez le traiteur d’eau BWT. «Un programme de contrôle des émissions de PFAS dans les eaux usées traitées des stations d’épuration urbaines sera mis en place en 2024 pour les STEU de plus de 10000 équivalent-habitants (environ 1300 installations)» précise également le plan interministériel. Pourquoi là? La raison en est simple: puisque les STEU collectent tous nos effluents domestiques et une bonne partie des effluents professionnels (artisans, petite industrie, garages…), elles constituent un excellent point d’observation de la situation globale. Il s’agit là d’établir un état des lieux général. Il ne faut toutefois pas oublier que ces PFAS pourraient être aussi présents dans les boues de STEU, et risquent de contaminer les nappes en cas d’épandage.
Les masses d’eau souterraines peuvent
également être contrôlées, d’une part
pour vérifier les ressources que l’on
souhaite potabiliser et, de façon plus
générale, pour établir un état des lieux de
la pollution environnementale, en particulier à proximité d’industries productrices. Des cartes très «parlantes» sont
à cet égard publiées, comme notamment
celle du journal Le Monde. «Les scandales sanitaires des pays voisins, où des
pollutions aux PFAS ont été retrouvées
dans les masses d’eau, loin des industries polluantes, sont également riches en
enseignements. L’état des lieux doit donc
être proportionnel au pouvoir de diffusion des PFAS», souligne Oliver Chilcott.
L’eau potable distribuée, enfin, est
contrôlée pour d’évidentes raisons
sanitaires. Le gouvernement mandate
régulièrement l’ANSES pour des campagnes exploratoires, sur les 20 PFAS
de la directive européenne mais aussi
sur d’autres molécules de cette famille,
dont quelques PFAS à chaîne très courte.
COMMENT LES MESURER ?
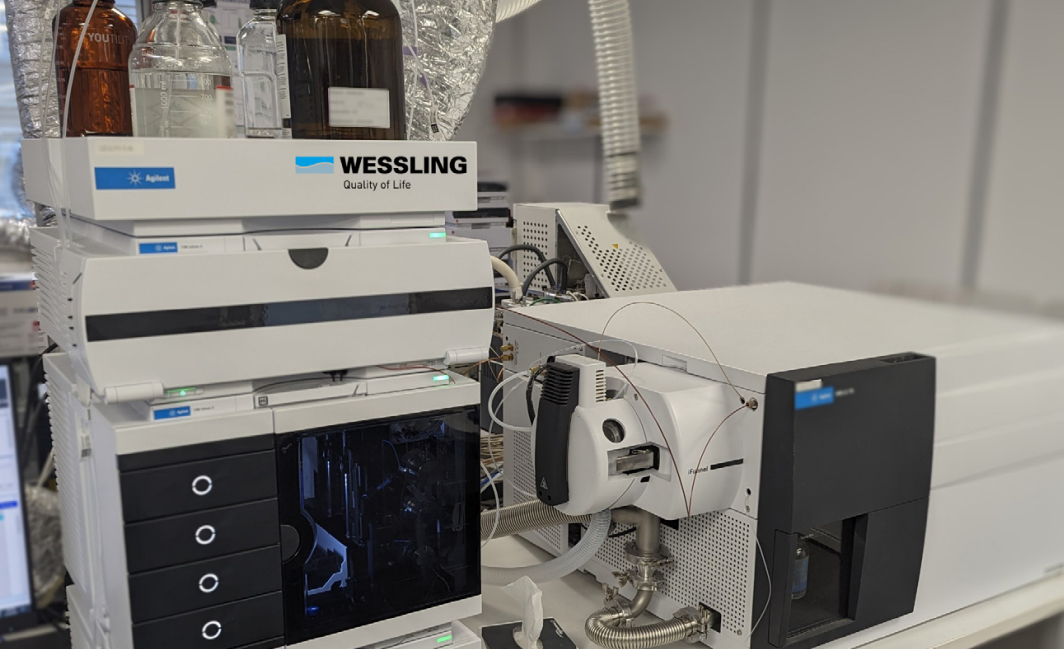
A l’évidence, on ne va pas «chercher» les mêmes niveaux de PFAS dans les effluents d’un producteur que dans les EDCH. Cette dernière mesure, la seule actuellement adossée à des seuils réglementaires, est la plus exigeante, et c’est donc sur elle que doivent s’aligner les laboratoires, comme entre autres SGS ou Wessling France. Or il s’agit de doser des ng/L, ce qui demande des procédures avancées. «Les techniques existent. Les questions se posent plutôt au niveau de l’approvisionnement en standards analytiques, de la quantité et de la diversité des composés à analyser et des contaminations extérieures à l’échantillon possible» souligne Julien Paupier, Responsable du pôle Chromatographie Liquide du laboratoire Wessling France. «En France, notamment pour les sept composés considérés comme les plus dangereux, les laboratoires doivent actuellement parvenir à une Limite de Quantification (LQ) de 2 ng/L. De plus, les seuils vont être amenés à baisser et nous devons nous préparer à descendre encore plus bas» prévient-il.
En termes techniques, pour des molécules connues à l’avance, par exemple les 20 PFAS de la liste européenne, la méthode la plus performante reste la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS). «Elle nécessite cependant une phase préparatoire de concentration-purification de l’échantillon. C’est délicat, lourd et onéreux. De plus cette méthode ne peut s’appliquer qu’à un nombre limité de composés» précise Julien Paupier. Pour le «Total PFAS», la méthode n’est pas encore arrêtée. «Collectivement, nous ne sommes pas prêts. Les laboratoires ont besoin de standards purs de toutes les molécules à analyser pour pouvoir calibrer leurs appareils. Cela demandera encore du développement, et des financements» souligne-t-il. Actuellement, le gouvernement indique une méthode indirecte, la mesure de l’AOF, un indicateur de présence de fluor organique. «Le seuil de quantification est beaucoup plus haut, de l’ordre de 2 microgrammes/L, sur le cumul de plusieurs substances fluorées, avec des composés qui répondront plus ou moins que d’autres. Cela donne une indication mais ce n’est pas parfait» argumente Julien Paupier.

Avant même la mesure proprement dite, le prélèvement d’échantillon représente un défi. «Sachant que l’on cherche des doses très faibles et que les PFAS sont omniprésents, y compris, potentiellement, sur l’opérateur ou dans son matériel, le gros problème sera de prélever sans contaminer les échantillons» prévient Olivier Sibourg (Ramboll), c’est pour cela que nous avons développés des protocoles de prélèvement spécifiques à ces composés quelles que soient les matrices analysées. Wessling et SGS déploient d’ailleurs à cet effet un service de prélévements accrédités sur tout le territoire national. Même le flacon d’échantillonnage pose problème... «Les PFAS sont une famille de plus de 10000 composés, aux propriétés physicochimiques différentes. Certains restent dans l’eau, d’autres s’adsorbent sur les matériaux, dont celui du flacon. Par exemple, le verre est à proscrire. Le téflon, pourtant très utilisé en chimie analytique, est évidemment éliminé puisque c’est un PFAS. Nous avons réa- lisé des essais pour valider au laboratoire un contenant adapté, et c’est le polyéthylène qui donne les meilleurs résultats» précise Julien Paupier (Wessling). Le site Wessling France de Lyon est accrédité pour réaliser les analyses dans les eaux douces et eaux résiduaires (accréditation n°1-1364) et peut réaliser des analyses dans les sols. «Pour répondre à des demandes, nous commençons également à travailler sur une méthode pour analyser les boues de STEU» ajoute Julien Paupier.
Les clients sont essentiellement des industriels (automobile, chimie...) qui font analyser leurs effluents à la recherche des 20 PFAS de la liste européenne, plus 8 optionnels. Des bureaux d’études et des sociétés de dépollution font aussi appel à Wessling France. «Nous ne sommes pas présents actuellement sur le marché de l’eau potable en France mais en faisons à l’étranger» précise Sagessa Raesch, Responsable Communication France chez Wessling France. En termes de méthodes analytiques, des évolutions sont encore à venir. «Les 20 PFAS de la liste comportent des chaînes de quatre à 15 ou 17 atomes de carbone. Avec une seule méthode, il est difficile d’analyser des composés avec de grande différence de propriété physico-chimique. Pour les petits composés très polaires, comme par exemple le TFA, il est nécessaire de développer une méthode plus adaptée à cette famille. Ces composés, qui ne sont pas encore pris en compte par la réglementation, ont une forte affinité pour l’eau, plus que pour les matériaux solides.» prévoit Julien Paupier. Par ailleurs, pour prendre en compte plus de composés que ceux de la liste, y compris ceux que l’on ne sait pas encore analyser directement, une nouvelle méthode émerge: le Top assay, qui comporte une phase d’oxydation. Là aussi, c’est un processus encore assez long et onéreux.
«Toutefois, nous commençons à avoir un solide retour d’expérience sur cette méthodologie qui est d’ores et déjà déployée par SGS en Belgique. Sur le plan de la levée des risques, elle s’avère intéressante et son prix commence à baisser mécaniquement» précise Sébastien Peureux, Directeur des activités environnementales de SGS France. «De nouvelles méthodes telles que les chaînes courtes (USC) et le screening non ciblé (basé sur l’UPLC-QTOF) représentent également des voies d’avenir que nous creusons actuellement au sein de nos laboratoires». Il faut enfin noter que, pour l’instant, tous les interlocuteurs s’accordent sur le fait qu’il n’existe sur le marché aucun appareil de détection et encore moins de mesure en ligne. Il faut en passer par l’analyse au laboratoire. Dans ce cadre, Georges Ruck, Directeur Data Science et R&D chez ViewPoint Biosurveillance de l’Eau confirme, qu’en vue de la mobilisation attendue des technologies de biomonitoring pour la surveillance des PFAS, des tests de sensibilité sont en cours avec la station de biosurveillance en ligne ToxMate.
SUEZ a pour sa part lancé un vaste
programme de recherche, déployé sur
les différentes matrices pouvant être
concernées par les PFAS telles que les
eaux potables, les eaux usées municipales ou industrielles, les boues, les
lixiviats de décharge et les fumées d’incinérateurs. L’objectif est de caractériser de façon holistique les niveaux de
concentrations en PFAS dans les différents compartiments et définir les meilleures stratégies pour les éliminer.
Dans le cadre de ce programme, SUEZ a
développé ses propres méthodes analytiques internes. Un protocole rigoureux
a ainsi été mis au point pour pouvoir
détecter et quantifier une soixantaine
de PFAS en une seule méthode pour
les matrices eau potable et une autre
méthode dédiée aux matrices chargées
(eaux usées et lixiviats). Les 60 PFAS
ciblés couvrent les listes des réglementations en vigueur aux Etats Unis, en
Europe et dans d’autres pays comme le
Canada ou le Danemark. Sont également
inclus des PFAS émergents, cités dans
la littérature scientifique, ainsi que des
précurseurs ou sous-produits de PFAS
pour appréhender le comportement global des PFAS de l’environnement.
COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?
Une fois le diagnostic établi se pose la question de l’intervention. Les mesures de diminution à la source sont inévitables à terme mais la contamination est déjà là: il faut dépolluer. Il existe un panel de techniques, non spécifiques, qui peuvent s’adapter aux PFAS et sont d’ailleurs déjà utilisées sur le terrain, en particulier dans le domaine de la réhabilitation des sites et sols pollués. Charbon actif, résines échangeuses d’ions, membranes ou fractionnement de mousse se disputent ce marché en devenir. Toutes sont des techniques de concentration: elles permettent de retirer les PFAS d’un milieu mais il faudra ensuite détruire des matériaux ou effluents chargés en polluants, ce qui n’a rien d’évident étant donné la stabilité de ces composés. Par ailleurs, car l’objectif est d’éliminer des concentrations relativement faibles de PFAS, il faut auparavant débarrasser l’eau à traiter des matières organiques et autres polluants abondants qui, sinon, risqueraient de saturer le dispositif d’élimination des PFAS. Les traiteurs d’eau industrielle (Chemdoc, Lenntech, Aquaprox, BWT, Atlantique Industrie, Waterleau, Nijhuis Saur Industrie, Ajelchim, Vivlo, John Cockerill …), les sociétés de dépollution (Valgo, Serpol, Ortec Soleo, Sarpi, Remea, Züblin…) ou les opérateurs de l’eau potable et de l’assainissement (Veolia, Suez, Saur…), ont donc le choix.
La technique citée le plus souvent, et la plus utilisée actuellement, est l’adsorption sur charbon actif. C’est le domaine de fournisseurs comme Puragen ou Cabot, ou encore DESOTEC, avec ses filtres mobiles à base de charbon actif. «Sur des eaux faiblement concentrées en PFAS, c’est certainement une bonne solution» admet Ludovic Lemieux (BWT). S’il ne le fait pas encore en France, le groupe Veolia utilise massivement les traitements à base de charbon actif en grains pour la potabilisation d’eau aux Etats-Unis, pays où la réglementation est d’ores et déjà plus stricte que ce qui est actuellement prévu en Europe. Veolia possède également un parc d’unités mobiles de traitement, destinées à répondre rapidement aux collectivités confrontées à des problèmes de qualité ou de manque d’eau. Ce parc contient notamment plusieurs filtres à charbon actif, pouvant être équipés avec un charbon actif réaggloméré adapté au traitement des PFAS. Le groupe a ainsi récemment annoncé avoir «traité plus de 8 millions de m3 d’eau en utilisant près de 450 tonnes de charbon actif granulaire et d’autres matériaux» aux EtatsUnis.
En France, le groupe a engagé en novembre 2023 une campagne de mesure nationale, devant s’achever avant l’été 2024, sur les points de production d’eau potable qu’il opère. «Le charbon actif en grains (CAG) pour le traitement des EDCH est un marché compétitif, où les solutions les moins chères remportent les appels d’offre. Avec les PFAS, cela va changer: on se dirige vers des charbons de haut de gamme, dits réagglomérés. Cela représente une étape de production supplémentaire, entre la carbonisation et l’activation, pour obtenir un matériau plus dur, mieux calibré, plus adsorbant. Nous avons testé nos CAG de haut de gamme existants, qui fonctionnent sur les PFAS, mais avons néanmoins développé une nouvelle gamme spécifique» explique Eric Racofier, responsable des ventes chez Puragen. La société alimente essentiellement les grands délégataires ainsi que des régies, pour l’eau potable, mais voit arriver des projets en industrie. Reste que le charbon semble un peu moins efficace sur les PFAS à chaîne courte. Par ailleurs, il finit par se saturer et doit être renouvelé régulièrement. Un fois saturé, il est dirigé soit vers la réactivation, soit vers la destruction. «Nous réactivons le CAG dans nos fours en présence de vapeur d’eau et absence d’oxygène, ce qui permet de le réutiliser et donc diminue fortement notre empreinte carbone. Les fumées sont débarrassées des PFAS par un procédé de lavage des gaz. Forcément, ces eaux de lavage contiennent du fluor qui se retrouvera, sous forme inerte, dans les boues de notre STEU» admet Eric Racofier.
«Une étude récente démontre que la technologie du four à soles multiples (Multiple Hearth Furnace - MHF), combinée à une unité de réduction des gaz de combustion (Flue Gas Abatement - FGA) pour assurer une absence de dispersion dans l’atmosphère, est parfaitement adaptée à l'élimination complète des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) du charbon actif granulaire (CAG) en fin de vie lors de sa réactivation. La destruction jusqu'à 100% des composés PFAS contenus dans le CAG usé a lieu dans le four MHF lui-même.» précise Nicolas Maurisset, Directeur John Cockerill Solids & Waste, dont la technologie NesaCore™ MHF convient à la fois à l’activation et à la réactivation du charbon actif. Au total, donc, une solution efficace, peu chère, s’intégrant facilement dans les usines potabilisation qui en général utilisent déjà des filtres à CAG pour d’autres polluants, et ne consommant peu d’énergie. En revanche, le CAG trouve ses limites avec les PFAS à chaîne courte, est délicat à manipuler lors des remplacements, nécessite des installations de grande taille et génère des volumes importants de déchets à détruire ou régénérer. Au dela des filtres à charbon actifs, John Cockerill fournit aussi des skids d’OIBP (Osmose inverse basse pression) qui peuvent être mis en œuvre dans des filières de traitement d’eau potable pour l’élimination des PFAS.
«Ces technologies, comme la plupart des solutions technologiques de traitement existantes, consistent à piéger les PFAS dans une autre matrice sans les détruire. Il reste donc à définir la filière et les traitements avals de régénération et/ ou d’élimination des concentrats.» précise Alain Desvignes, directeur de John Cockerill Water. De son côté, NSI Mobile Water Solutions de Nijhuis Saur Industries propose l’élimination des PFAS grâce à la flottation, l’utilisation de résines échangeuses d’ions, ainsi que du charbon actif granulaire. Leur offre inclut des services allant des tests à l’analyse de l’eau du client, ainsi que l’installation d’une solution complète, comprenant des solutions mobiles temporaires «plug-and-play» ainsi que les pompes, cuves et tuyauterie nécessaires. Le principal avantage réside non seulement dans le service de bout en bout, mais aussi dans la possibilité offerte au client d’effectuer des tests pilotes préliminaires avec son budget d’exploitation avant de s’engager dans une installation fixe, réduisant ainsi les risques et optimisant les budgets.
La société DESOTEC propose des solutions de filtration avec des filtres mobiles à base de charbon actif en grains (CAG), qui ont prouvé leur efficacité tant pour la purification d’eaux souterraines que pour l’épuration des eaux usées industrielles, notamment les eaux usées des pompiers chargées en PFAS. Elle explique: «Les autres avantages de ce type de filtration mobile sont: une sécurité accrue (les polluants n’étant pas manipulés sur place), une plus grande flexibilité et un coût de propriété minimal, ce qui est d’une importance capitale dans l’environnement économique et financier actuel. Après des années de recherche et de développement, nous disposons de l’expertise nécessaire pour sélectionner le type de charbon actif et de filtre le plus approprié pour optimiser la purification des eaux usées contenant une quantité limitée de PFAS. Une fois qu’un filtre est saturé, il est emmené sur le site de traitement et de réactivation de DESOTEC, où le charbon usagé est vidé et traité de façon sûre et durable. Pour garantir une conformité totale avec le règlement européen rigoureux sur les PFAS, DESOTEC mesure avec précision le taux de PFAS adsorbé sur le charbon actif. Si la concentration en PFAS du charbon usagé est inférieure aux limites européennes, le charbon saturé sera soumis à un processus de réactivation thermique dans les installations de DESOTEC. Cette méthode réactive le charbon tout en décomposant les PFAS de manière complète et sûre, en deçà des seuils détectables, évitant ainsi leur rejet dans l’environnement».
«Pour lutter contre la présence de contaminants et plus particulièrement des PFAS présents dans l’eau. Il existe aujourd’hui, une solution de filtration spécialement adaptée aux installations résidentielles et collectives qui consiste à traiter l’eau à l’aide de charbon actif permettant d’éliminer jusqu’à 98% des PFOA/PFOS. Cette solution se décompose en deux points de filtration, l’un est disposé en amont du point d’utilisation et sert de préfiltration. L’autre est directement installé sous le point d’utilisation pour dispenser une filtration plus fine et permettre une élimination maximale des contaminants présents dans l’eau. La mise en place de ce système permet donc de supprimer significativement les PFOA/PFOS présents dans les réseaux eau potable», ajoute la société Efiltec.

La société allemande CarboTech travaille quant à elle sur des solutions fonctionnant grâce à un charbon actif produit à partir de matériaux organiques tels que la coquille de noix de coco ou le bois, ayant vocation à retenir les micropolluants (pesticides, solvants ou PFAS). Les fabricants de résines échangeuses d’ions, comme Purolite, ou Lanxess, se mettent également sur les rangs. Les résines peuvent en particulier prendre le relai du CAG pour retenir les PFAS à chaîne courte. Alors que le défi devient plus difficile et se concentre sur les PFAS à chaîne courte, Purolite propose des solutions sur mesure pour répondre aux cas les plus difficiles. En connaissant la composition de l’eau, la concentration et le débit de PFAS, Purolite peut simuler le processus et fournir la performance prévue. Pour les cas plus complexes, où la salinité de l’eau est élevée, le COT est élevé ou la concentration de PFAS est élevée, Purolite mène des études pilotes en Europe et aux États-Unis qui aident à développer et à commercialiser un procédé en deux étapes pour l’élimination des PFAS à chaîne courte, ultracourte et longue. La première étape utilise une résine échangeuse d’anionique régénérable pour éliminer principalement les PFAS à chaîne courte et ultracourte. Certains PFAS à longue chaîne devraient se lier à la résine régénérable, mais le débordement ou la fuite des PFAS à longue chaîne serait finalement éliminé par une autre résine sélective dans une deuxième étape. Il s’agira généralement d’une résine échangeuse d’anions à base forte (SBA) retenant les PFAS.
Pour le traitement des PFAS, Lanxess présente une gamme de trois résines, dont deux développées spécifiquement ces dernières années. La MP 62 WS est une résine anionique généraliste, facilement régénérable à la soude, qui peut traiter des effluents très chargés, en sortie d’usine ou de STEP. «Du fait de sa sélectivité moyenne, elle retient d’autres anions également mais fait le gros du travail, en passant de mg/L, ou plus, à des microgrammes/L» affirme Simon Libert, Responsable des ventes France chez Lanxess. Pour le même type de travail, Lanxess propose aussi la MonoPlus TP 109, plus spécifique des PFAS et qui se régénère avec une solution de méthanol et sel. Pour la finition, Lanxess a développé la TP 108, sélective des PFAS mais non régénérable. Cette résine à usage unique doit donc être employée après les autres ou sur des eaux faiblement concentrées en PFAS comme des eaux de forage pour descendre aux concentrations requises (de l’ordre du ng/L). Il en existe une version, dite TP 108 DW, compatible avec l’eau potable. Elle est certifiée NSF aux Etats-Unis, et en cours de certification en France (Attestation de conformité sanitaire, ou ACS) et en Allemagne.
«Certains gros producteurs d’eau potable, comme le Sedif, utilisent des membranes pour traiter leur eau brute. On peut alors directement installer une TP 108 derrière pour éliminer le reste des PFAS» imagine Simon Libert. Lanxess n’a pas encore réalisé d’installation en France pour les PFAS mais peut déjà citer des références dans le monde. «La demande explose. Tous les traiteurs d’eau, tous les dépollueurs de sites et sols se préoccupent des PFAS. Pour janvier 2026, lors de l’entrée en vigueur de la directive sur les EDCH, il faudra au moins une résine ACS sur le marché» prévient Simon Libert. Faciles à manipuler, demandant des réacteurs moins encombrants que les filtres à charbon, efficaces sur les PFAS à chaînes courtes, les résines consomment en revache des produits chimiques, ou doivent être détruites si non régénérables. Elles sont aussi plus chères. La société Purolite développe également de nouveaux adsorbants pour l’élimination des PFAS: «Face au défi que représentent les PFAS à chaîne courte, nous proposons des solutions destinées à des cas complexes, notamment quand la salinité de l’eau est élevée, ainsi que le COT, ou la concentration de PFAS. Purolite mène ainsi des études pilotes en Europe et aux États-Unis visant à développer et à commercialiser un procédé en deux étapes pour l’élimination des PFAS à chaîne courte, ultracourte et longue. La première étape utilise une résine échangeuse d’anionique régénérable pour éliminer principalement les PFAS à chaîne courte et ultracourte. Certains PFAS à longue chaîne devraient se lier à la résine régénérable, mais le débordement ou la fuite des PFAS à longue chaîne serait finalement éliminé par une autre résine sélective dans une deuxième étape. Il s’agira généralement d’une résine échangeuse d’anions à base forte (SBA) retenant les PFAS», explique Rodrigo Salvatierra, de chez Purolite.
Les membranes, comme en produisent par exemple Polymem, Toray, Veolia WTS, Dupont, ou NX Filtration, pourraient également faire partie de la solution. Une installation d’osmose inverse ou de nanofiltration fibre creuse peut parfaitement retirer tous les PFAS d’une eau. Il s’agit cependant d’installations chères, énergivores et produisant un volume assez important de concentrat chargé en PFAS, qui doit ensuite être traité, pour produire à son tour un résidu qu’il faut détruire. «De par leurs seuils de coupure compris entre 400 et 800 daltons, les membranes de nanofiltration sur fibres creuses retiennent déjà efficacement un grand nombre de PFAS, elles ont également la propriété de retenir beaucoup de polluants (matière organique, MES, etc.) pouvant rentrer en compétition avec les PFAS dans les procédés d’adsorption, d’échange d’ions ou d’oxydation avancée», explique Rémi Duvillard, ingénieur commercial chez NX Filtration. Pour les effluents industriels, plus chargés, BWT adopte une démarche de destruction sur place, et non de concentration. «Nous partons de notre dispositif ECO-UV qui combine les UVC et le peroxyde d’hydrogène. Il est classiquement utilisé pour traiter les bactéries et la matière organique mais, avec un dimensionnement différent, il peut détruire les PFAS. Les UVC, en photolysant le peroxyde d’hydrogène, libèrent en effet des radicaux libres qui sont des super-oxydants capables de casser la liaison carbone-fluor des PFAS» explique Ludovic Lemieux (BWT).
BWT réalise actuellement des tests sur des échantillons pollués. Si les PFAS sont effectivement détruits par oxydation avancée, le procédé produit inévitablement des fluorures dont il faut ensuite se débarrasser. SUEZ travaille également sur des solutions de traitement des rejets générés par des industriels fabricants ou utilisateurs de produits contenant des PFAS. Par exemple, SUEZ mène actuellement une étude-pilote complète sur une plateforme industrielle, qui vise à tester l’efficacité de différents procédés de traitement de façon unitaire et en combinaison sur différents types d’effluents: les procédés testés mettent en œuvre du charbon actif, des résines, du fractionnement de mousses ou encore de l’électro-oxydation. Chaque détenteur d’une technologie prêche évidemment pour sa paroisse mais il semble bien que les solutions à venir seront des combinaisons. «Nous partons du principe que c’est l’approche multi-technologies qui conviendra car on ne peut pas tout faire avec l’osmose inverse, le charbon ou les résines. On peut par exemple envisager un traitement combinant un étage de CAG ou osmose suivi d’une finition sur résine» envisage ainsi Simon Libert (Lanxess). «Allonsnous vers des filières combinées? Les CAG seraient-ils plus actifs sur des molécules déjà un peu cassées par oxydation avancée? Faut-il utiliser des membranes pour concentrer au maximum les PFAS puis les détruire par oxydation avancée ? On ne sait pas. Il faut surtout, à ce stade, éviter le lobbying de telle ou telle technologie» souligne Ludovic Lemieux.
Il plaide d’ailleurs pour la mise en place d’un groupe de travail réunissant les porteurs des différentes technologies et les industriels producteurs de PFAS afin de réaliser des essais conjoints, avec le soutien financier de l’Etat et des administrations puisqu’il s’agit d’un problème de santé publique. Une autre technologie intéressante est l’électro oxydation, note par ailleurs la société Treewater, spécialisée dans le traitement et recyclage des effluents industriels : «Cette technologie permet une oxydation directe des PFAS (rupture de liaison C-C) mais également génère des mécanismes de réduction. Cette technologie a présenté d’excellents résultats sur les molécules mères de PFAS (> 90% d’abattement sur matrice simples et réelles) mais également sur l’abattement des sous-produits générés (forte diminution de l’AOF au cours du traitement)». Depuis plusieurs années, Ginger LECES a développé et validé une méthode de mesure des PFAS dans les rejets atmosphériques selon le référentiel américain EPA OTM-45. Cette méthode permet de quantifier la concentration de 49 composés PFAS semi-volatils dans les émissions des installations industrielles, première étape pour permettre de réduire les émissions. Ginger LECES a également mené plusieurs campagnes de mesures sur les PFAS pour différents industriels de la région lyonnaise et dans différents domaines d’activité.
DÉJÀ QUELQUES RÉALISATIONS
Il est au moins un domaine où des dispositifs de traitement des PFAS fonctionnent déjà: la réhabilitation des sites et sols pollués. La société allemande Züblin conçoit, fabrique et met en service des installations pour des clients qui interviennent sur des sites pollués aux PFAS, par exemple près d’aéroports ou d’usines. Züblin revendique une soixantaine d’installations depuis 15 ans, partout en Europe. «Outre les aéroports, nous avons des projets dans l’industrie chimique, la pétrochimie, la raffinerie, mais aussi pour des eaux de lavage de sprinklers anti-incendie» énumère Hans-Georg Edel, Responsable marketing et scientifique chez Züblin. Avec quelles technologies ? «Dans 90% des cas, nous utilisons des charbons actifs, c’est plus économique et très efficace. Le choix de la technique dépend toutefois de l’analyse de l’eau à traiter et des objectifs du client. S’il y a des PFAS à chaîne courte, nous ajoutons des résines. Si la concentration initiale est élevée, il faut d’abord utiliser le fractionnement par moussage» explique Michael Linke, responsable du bureau de calcul chez Züblin. Cette dernière technique, plus récente mais en plein en développement, consiste à injecter de l’air dans la masse d’eau polluée. De par leurs propriétés moléculaires, comparables à celles de savons, les PFAS se placent à l’interface entre l’eau et l’air, formant une mousse qu’il «suffit» ensuite de récolter en surface.
«Si l’effluent initial est très chargé, il devient beaucoup trop coûteux de le traiter au charbon actif ou à la résine. Mieux vaut d’abord éliminer 90% des PFAS avec cette mousse puis traiter le reste avec les techniques connues et très efficaces. Nous travaillons actuellement sur l’amélioration de ce type de prétraitement, c’est l’avenir» affirme Nicolas Etard, Ingénieur projets chez Züblin France. Cette avancée suscite également un vif intérêt au sein du département R&D de NX Filtration pour le traitement des concentrats issus des membranes de nanofiltration sur fibres creuses. «En renvoyant ces concentrats ainsi traités en amont de notre procédé membranaire, nous pourrions grandement accroître le rendement hydraulique de la filière membranaire», souligne Rémi Duvillard.
Spuma, startup incubée par VALGO, développe pour sa part une technique originale bien qu’apparentée au fractionnement des mousses. Elle s’inspire … de la protéine qui véhicule les PFAS dans le sang des mammifères. Cette dernière n’étant évidemment pas disponible en grandes quantités, Spuma a identifié une protéine d’origine naturelle aux propriétés équivalentes. «C’est une véritable éponge moléculaire pour PFAS. On l’ajoute à l’eau à traiter et les PFAS se fixent dessus. Si on injecte des bulles d’air, elle forme en surface une mousse ferme et dense, facilement collectable. Avec quelques minutes de bullage, nous obtenons des valeurs résiduelles de 0,5 ng/L, sur le PFOA et le PFOS, à partir de concentrations cent ou mille fois plus élevées. C’est un traitement très compétitif, peu énergivore et adapté aux gros volumes» revendique Eric Branquet, gérant d’Ecofield Consulting, qui a encadré le programme de recherche de Spuma. Spuma a breveté une solution comprenant cet additif et un système particulier d’injection d’air car les bulles doivent avoir des caractéristiques précises.
«Après des essais au laboratoire
puis des pilotes sur quelques m3
d’effluents
pollués, nous réalisons actuellement des
essais dans le Nord de l’Europe sur des
dizaines de m3
, avec d’excellents résultats.
L’objectif est de passer à des centaines de
m3
pour dépolluer des eaux industrielles,
des rejets de STEU, voire des nappes…»
prévoit Eric Branquet.
Il ne faut pas se leurrer : entre la surveillance des milieux, le traitement des
EDCH ou des effluents industriels et la
réhabilitation des masses d’eau et des
sols, des milliards d’euros sont à trouver. Qui va supporter le coût de cette
dépollution? «Dans certains pays, dans
le cadre de poursuites judiciaires, des
industriels ont accepté de verser plusieurs milliards de dollars pour aider les
collectivités à traiter les eaux à potables.
Qui va payer en France, ne serait-ce que
le traitement de l’eau potable? Les collectivités? Les consommateurs? Les industriels pollueurs?» s’interroge ainsi Olivier
Sibourg, de Ramboll.